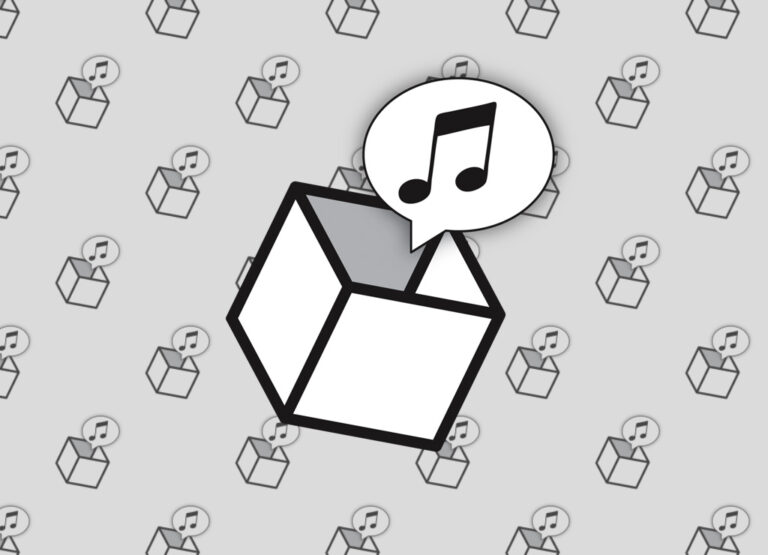Le Monde illustré (81-82), 30 octobre et 6 novembre 1858
Un peu plus tard, M. Masson, maître de chapelle de l’église de Saint-Roch, me proposa d’écrire une messe solennelle, qu’il ferait exécuter, disait-il, dans cette église, le jour des saints Innocents, fête patronale des enfants de chœur. Nous devions avoir cent musiciens de choix à l’orchestre, un chœur plus nombreux encore ; on étudierait les parties de chant pendant un mois ; la copie ne me coûterait rien, ce travail serait fait gratuitement et avec soin par les enfants de chœur de Saint-Roch, etc., etc. Je me mis donc, plein d’ardeur, à écrire cette messe, dont le style, avec sa coloration inégale et en quelque sorte accidentelle, ne fut qu’une imitation maladroite du style de Lesueur. Ainsi que la plupart des maîtres, celui-ci, dans l’examen qu’il fit de ma partition, approuva surtout les passages où sa manière était le plus fidèlement reproduite. À peine terminé, je mis le manuscrit entre les mains de M. Masson, qui en confia la copie et l’étude à ses jeunes élèves. Il me jurait toujours ses grands dieux que l’exécution serait pompeuse et excellente. Il nous manquait seulement un habile chef d’orchestre, ni lui ni moi n’ayant l’habitude de diriger d’aussi grandes masses de voix et d’instruments. M. Valentino était alors à la tête de l’orchestre de l’Opéra, il aspirait à l’honneur d’avoir aussi sous ses ordres celui de la chapelle royale. Il n’aurait garde, sans doute, de rien refuser à mon maître, qui était surintendant de cette chapelle. En effet, une lettre de Lesueur que je lui portai le décida, malgré sa défiance des moyens d’exécution dont je pourrais disposer, à me promettre son concours. Le jour de la répétition générale arriva, et, nos grandes masses vocales et instrumentales réunies, il se trouva que nous avions pour tout bien vingt choristes, dont quinze ténors et cinq basses, douze enfants, neuf violons, un alto, un hautbois, un cor et un basson. On juge de mon désespoir et de ma honte en offrant à Valentino, à ce chef renommé d’un des premiers orchestres du monde, une telle phalange musicale ! — « Soyez tranquilles, disait toujours maître Masson, il ne manquera personne demain à l’exécution. Répétons ! répétons ! » Valentino résigné donne le signal, on commence ; mais, après quelques instants, il faut s’arrêter à cause des innombrables fautes de copie que chacun signale dans les parties. Ici on a oublié d’écrire les bémols et les dièses à la clef, là il manque dix pauses, plus loin on a omis trente mesures. C’est un gâchis à ne pas se reconnaître ; je souffre tous les tourments de l’enfer ; et nous devons enfin renoncer absolument, pour cette fois, à réaliser mon rêve si longtemps caressé d’une exécution à grand orchestre.

Cette leçon au moins ne fut pas perdue. Le peu que j’avais entendu de ma composition malheureuse m’ayant fait découvrir ses défauts les plus saillants, je pris aussitôt une résolution radicale dans laquelle Valentino me raffermit en me promettant de ne pas m’abandonner lorsqu’il s’agirait, plus tard, de prendre ma revanche. Je refis cette messe presque entièrement. Mais, pendant que j’y travaillais, mes parents, avertis de ce fiasco, ne manquèrent pas d’en tirer un vigoureux parti pour battre en brèche ma prétendue vocation et tourner en ridicule mes ambitieuses espérances. Ce fut là la lie de mon calice d’amertume. Je l’avalai en silence, et n’en persistai pas moins.
La partition terminée, convaincu par une triste expérience que je ne pouvais me fier à personne pour ce travail, et ne pouvant, faute d’argent, employer des copistes de profession, je me mis à extraire moi-même les parties, à les doubler, tripler, quadrupler, etc. Au bout de trois mois, elles furent prêtes. Je demeurai alors aussi empêché avec ma messe que Robinson avec son grand canot qu’il ne pouvait lancer ; les moyens de la faire exécuter me manquaient absolument. Compter de nouveau sur les masses musicales de M. Masson eût été par trop naïf ; inviter moi-même les artistes dont j’avais besoin, je n’en connaissais personnellement aucun ; recourir à l’assistance des musiciens de la chapelle royale sous l’égide de mon maître, il avait déclaré la chose impossible. Ce fut alors que mon ami Humbert Ferrand, dont je parlerai bientôt plus au long, conçut la pensée, passablement hardie, de me faire écrire à Chateaubriand, comme au seul homme capable de comprendre et d’accueillir une telle demande, pour le prier de me mettre à même d’organiser l’exécution de ma messe en me prêtant 1 200 fr. Chateaubriand me répondit la lettre suivante :
« Paris, ce 31 décembre 1824.
Vous me demandez douze cents francs, monsieur ; je ne les ai pas ; je vous les enverrais si je les avais. Je n’ai aucun moyen de vous servir auprès des ministres. Je prends, monsieur, une vive part à vos peines. J’aime les arts et honore les artistes ; mais les épreuves où le talent est mis quelquefois le font triompher et le jour du succès dédommage de tout ce qu’on a souffert. Recevez, monsieur, tous mes regrets ; ils sont bien sincères !
CHATEAUBRIAND. »

Mon découragement devint donc extrême ; je n’avais rien de spécieux à répliquer aux lettres dont mes parents m’accablaient ; déjà ils menaçaient de me retirer la modique pension qui me faisait vivre à Paris, quand le hasard me fit rencontrer, à une représentation de la Didon de Piccini, à l’Opéra, un jeune et savant amateur de musique, d’un caractère généreux et bouillant, qui avait assisté en trépignant de colère à ma débâcle musicale de Saint-Roch. Il appartenait à une famille noble du faubourg Saint-Germain et jouissait d’une certaine aisance. Il s’est ruiné depuis lors ; il a épousé, malgré sa mère, une médiocre cantatrice, élève du Conservatoire ; il s’est fait acteur quand elle a débuté ; il l’a suivie, en chantant l’opéra, dans les provinces de France et en Italie. Abandonné au bout de quelques années par sa prima donna, il est revenu végéter à Paris en donnant des leçons de chant. J’ai eu quelquefois l’occasion de lui être utile dans mes feuilletons du Journal des débats ; mais c’est un poignant regret pour moi de n’avoir pu faire davantage ; car le service qu’il m’a rendu spontanément a exercé une grande influence sur toute ma carrière, je ne l’oublierai jamais. Il se nommait Augustin de Pons. Il vivait avec bien de la peine, l’an dernier, du produit de ses leçons ! Qu’est-il devenu après la révolution de Février, qui a dû lui enlever tous ses élèves ?… je tremble d’y songer…
En m’apercevant au foyer de l’Opéra :
— Eh bien, s’écria t-il de toute la force de ses robustes poumons, et cette messe ! est-elle refaite ? quand l’exécutons-nous tout de bon ?
— Mon Dieu, oui, elle est refaite et, de plus, recopiée. Mais comment voulez-vous que je la fasse exécuter ?
— Comment ? parbleu, en payant les artistes. Que vous faut-il ? voyons ! douze cents francs ? quinze cents francs ? deux mille francs ? je vous les prêterai, moi.
— De grâce, ne criez pas si fort. Si vous parlez sérieusement je serai trop heureux d’accepter votre offre, et douze cents francs me suffiront.
— C’est dit. Venez chez moi demain matin, j’aurai votre affaire. Nous engagerons tous les choristes de l’Opéra et un vigoureux orchestre. Il faut que Valentino soit content, il faut que nous soyons contents, il faut que cela marche, sacrebleu !

Et de fait cela marcha. Ma messe fut splendidement exécutée dans l’église de Saint-Roch, sous la direction de Valentino, devant un nombreux auditoire ; les journaux en parlèrent favorablement, et je parvins ainsi, grâce à ce brave de Pons, à m’entendre et à me faire entendre pour la première fois. Tous les compositeurs savent quelle est l’importance et la difficulté, à Paris, de mettre ainsi le pied à l’étrier.
Cette partition fut encore exécutée longtemps après (en 1827) dans l’église de Saint-Eustache, le jour même de la grande émeute de la rue Saint-Denis. L’orchestre et les chœurs de l’Odéon m’étaient venus en aide cette fois gratuitement, et j’avais osé entreprendre de les diriger moi-même. À part quelques inadvertances causées par l’émotion, je m’en tirai assez bien. Que j’étais loin, pourtant, de posséder les mille qualités de précision, de souplesse, de chaleur, de sensibilité et de sang-froid, unies à un instinct indéfinissable, qui constituent le talent du vrai chef d’orchestre ! et qu’il m’a fallu de temps, d’exercice et de réflexions pour en acquérir quelques-unes ! Nous nous plaignons souvent de la rareté des bons chanteurs, les bons directeurs d’orchestre sont bien plus rares encore, et leur importance, dans une foule de cas, est bien autrement grande et redoutable pour les compositeurs.
Après cette nouvelle épreuve, ne pouvant conserver aucun doute sur le peu de valeur de ma messe, j’en détachai le Resurrexit, dont j’étais assez content, et je brûlai le reste, en compagnie de la scène de Beverley, pour laquelle ma passion s’était fort apaisée, de l’opéra d’Estelle et d’un oratorio latin (le Passage de la mer Rouge), que je venais d’achever. Un froid coup d’œil d’inquisiteur m’avait fait reconnaître ses droits incontestables à figurer dans cet autodafé.
Hector Berlioz